Amadou Sadjo Barry
Depuis les indépendances, le refus de l’alternance au pouvoir s’est imposé comme paradigme normal de gouvernement dans la grande majorité des pays africains. C’est ce que confirme l’intérêt désormais visible du président ivoirien Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Or, la normalisation d’une telle pratique témoigne d’une « désinstitutionnalisation » du pouvoir et traduit en même temps l’incapacité des responsables et partis politiques de s’approprier et d’assimiler les valeurs démocratiques qu’ils prétendent pourtant promouvoir. Mais c’est surtout l’image de sociétés fondées sur la souveraineté de l’autorité du plus fort que nous donne à voir cette volonté d’exercer un contrôle exclusif du pouvoir.
Qu’il s’agisse de la Côte d’Ivoire ou d’autres pays, nous sommes en face d’une rationalité politique qui place les contraintes juridiques et constitutionnelles sous la tutelle du président et de ceux qui détiennent ne serait-ce qu’une partie infime du pouvoir. Comme si le désir individuel et la puissance qui lui correspond avaient force de droit. Mais loin d’être une pathologie du politique, cette consécration de l’homme fort détermine largement le fonctionnement du système politique d’un grand nombre de pays africains, allant jusqu’à diffuser au sein même des partis d’opposition les pratiques autoritaires du pouvoir.
L’illusion de la souveraineté populaire ou le peuple introuvable
Si donc le refus de l’alternance au pouvoir et l’institutionnalisation de l’autoritarisme qui lui correspond s’avèrent les voies normales du politique en Afrique, n’est-ce pas l’idée même de la souveraineté populaire qui se trouve ainsi remise en cause? C’est un argument récurrent que de prétexter la volonté du peuple pour changer la limitation des mandats présidentiels ou pour s’ériger en sauveur de la nation. Mais dans un système politique où les pratiques autoritaires ont fait se confondre le peuple, le parti au pouvoir et la personne du chef, que peut-être la volonté populaire si non une illusion soigneusement entretenue par une vieille classe politique qui résume en elle seule soixante ans de désolation et de trahison?
C’est surtout l’image de sociétés fondées sur la souveraineté de l’autorité du plus fort que nous donne à voir cette volonté d’exercer un contrôle exclusif du pouvoir
C’est au nom du «peuple» qu’Alpha Condé a réussi son coup de force constitutionnel le 22 mars 2020. De son côté, Alassane Ouattara veut s’appuyer sur la nécessité de maintenir «l’ordre» pour justifier son indispensable présence à la tête de l’exécutif ivoirien. Les paysages politiques guinéens et ivoiriens laissent voir cependant des sociétés qui ne ressemblent en rien à des sociétés de peuple, celles qui se caractérisent par l’existence effective d’institutions politiques régies par une moralité minimale collective et contraignante sur les comportements, celles où des pouvoirs communs organisent la réciprocité des pouvoirs individuels et gèrent les conflits qu’engendre la vie en société.
Un abus de langage conduit très souvent à ignorer la signification éminemment normative du peuple. Et faut-il le rappeler: c’est l’absence d’un peuple politiquement constitué qui rend possible la confiscation du pouvoir. C’est pourquoi il faut interpréter le refus de l’alternance au pouvoir comme la conséquence d’un désordre politique, mais surtout moral.
L’ordre dévoyé
Dès lors, devient intenable l’argument du président Ouattara et de ses soutiens. Tout d’abord, on voit mal comment l’ordre qui n’a pas été garanti en dix ans de gouvernance deviendrait une possibilité dans un contexte électoral qui risque de replonger la Côte d’Ivoire dans le chaos. En réalité, le procès en expédition de Guillaume Soro et la volonté de Ouattara d’élaborer un plan de succession qui éloignerait davantage ses adversaires politiques du pouvoir, créent déjà les conditions d’une situation électorale et post-électorale explosive.
De même, l’espoir était permis que les crises politiques qui ont accompagné l’élection de l’actuel président en 2010 l’instruisent suffisamment de sorte qu’il lègue aux Ivoiriens un État fondé sur l’intérêt public, donc effectif et représentatif. Pour qu’enfin l’ordre soit institutionnellement fondé. Malheureusement, nous sommes encore au point où nous étions dans les années soixante : l’ordre est associé à la personne du président. Et il n’a jamais manqué d’alliés pour défendre une telle prétention morbide, manifestant au passage l’impuissance structurelle des institutions politiques. Comme quoi la culture politique ivoirienne, elle aussi, n’a rien perdu de son élan autoritaire.
Le procès en expédition de Guillaume Soro et la volonté de Ouattara d’élaborer un plan de succession qui éloignerait davantage ses protagonistes du pouvoir, créent déjà les conditions d’une situation électorale et post-électorale explosive
C’est pourtant cette continuité des logiques autoritaires et leurs renouvellements sous couvert de formalisme démocratique qu’il faut interrompre si l’on veut favoriser une pratique juste et responsable du pouvoir. Pour ce faire, nul besoin de briguer un troisième mandat, mais seulement de penser sans concession aucune le fondement du pouvoir en Afrique. Ce qui nécessitera de trouver d’autres formes de légitimité autres que l’autorité du président, l’armée ou encore les grandes puissances qui dominent la scène internationale. C’est à ce travail de refondation du pouvoir qu’aurait pu, entre autres, se consacrer Alassane Ouattara en ces dix années de règne, pour guider la Côte d’Ivoire vers la sortie définitive de l’autoritarisme.
Penser sans concession aucune le fondement du pouvoir en Afrique. Ce qui nécessitera de trouver d’autres formes de légitimité autres que l’autorité du président, l’armée ou encore les grandes puissances qui dominent la scène internationale
Malheureusement, alors que les crises politiques dans l’histoire de la Côte d’Ivoire et en Afrique de manière générale ont été liées à l’enjeu du pouvoir, les responsables politiques africains n’ont jamais pris au sérieux la problématique éthique et politique que représentent le contrôle et l’exercice du pouvoir. Ignorant ainsi que l’organisation de la vie commune implique de rendre effective l’existence de pouvoirs communs qui permettent à un ensemble d’individus de coexister de la meilleure façon possible.
Crédit photo : Africanewsquick.net
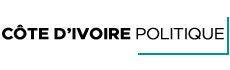

Commenter